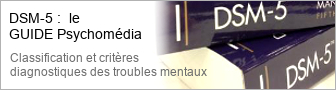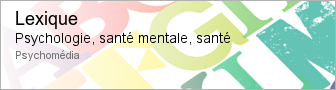PSYCHOLOGIE CLINIQUE informe de la parution du numéro 12 Posté le Mercredi 26 Septembre 2001 par Gestion
PSYCHOLOGIE CLINIQUE informe de la parution du numéro 12
Par ce mail, la rédaction de la revue PSYCHOLOGIE CLINIQUE informe de la parution du numéro 12 de la revue PSYCHOLOGIE CLINIQUE, paru cette année et intitulé "Dispositifs Clinique : recherches et interventions", paru à Paris chez
Dirigé par O. Douville et C. Wacjman il expose et explore les questions suivantes :
La recherche en psychologie clinique éclaire et enrichit ses dispositifs autant dans les domaines
professionnels du psychologue que dans ceux qui, faisant irruption du social et transformant le social, influent
sur la clinique de celui-ci. Nous avons voulu présenter à nos lecteurs en un premier point ce qu'elles sont et ce
qu'elles ont de commun sur le plan des avancées et des interrogations de la clinique, sur le plan éthique et sur
le plan méthodologique. Serge Blondeau nous montre comment ce travail ardu ne doit pas méconnaître
l'écueil qui consisterait à vouloir rendre compte de la totalité d'un objet au risque de se fourvoyer dans un
réductionnisme dommageable, pas plus que de ne pas tenir compte de la subjectivité du chercheur. Nadine
Proia nous entraîne sur le chemin de l'épistémologie des sciences cognitives. Elle fait elle aussi référence à la
philosophie, celle de D. Davidson, anti-réductionniste, qui montre que la psychologie clinique a sa place au
sein des sciences. Dans le cadre des méthodologies qualitatives en clinique, usitées dans les pays
anglo-saxons, Marie Santiago-Delefosse dégage quelques enseignement possibles pour la psychologie
clinique française. Ces méthodologies (ré)apparaissent au carrefour de la sociologie et de la nécessité de
réintroduire des entités mentales dans la sphère du discours.
Le second grand volet de ce numéro se centre sur la question du social comme champ d'action du
psychologue. La difficulté reste que s'il veut rester dans une approche clinique, le sens de son travail doit être
guidé par une capacité à entendre ce que de très nombreux analyseurs de la réalité mettent au premier plan
d'un discours ou cachent derrière le symptôme social. Ainsi, Jacqueline Barrus-Michel attire notre attention sur
les rupture du tissu social qui font symptôme, ce qui facilite une déconstruction des systèmes de référence
sociaux et des unités instituées qui se donnent alors à voir dans les éclats et à entendre dans les débats
suscités. Ces ruptures symptômatiques sont remarquables au point d'être sanctionnées par l'autorité judiciaire
qui, écrit Yolande Govindama, avec la clinique a tendance à se trouver en opposition ou à être conçue comme
juxtaposée, alors que l¹objet de préoccupation, la généalogie est commun.
Le troisième volet concerne des aspects de la recherche clinique en psychanalyse. Michèle Porte nous
rappelle que la grande analogie de Totem et tabou est une singularité organisatrice de l'¦uvre de Freud.
Jean-Claude Maleval examine comment, sur le marché des psychothérapies on dit faire mieux, plus vite et
moins cher que la psychanalyse. Il précise comment la volonté d'inscrire la psychanalyse dans le discours de la
science fait obstacle au discernement de l'éthique qui lui est inhérente. Olivier Douville précise que les
avancées de la recherche clinique ne peuvent se faire au détriment de la notion de sujet, entendu en terme de
division fondatrice.
L¹actuel en ses effets d¹abrasion de la tension subjective produit, en retour, une violence. L'analyse des effets
de la violence permet au psychologue de penser les conditions pour une sortie du silence, tant pour les
victimes que pour le tiers social interpellé comme témoin. C'est ce que Jean-Pierre Durif-Varembont aborde
dans les deux dimensions fondamentales des victimes de violence, surtout pour les enfants qui s'enferment
dans le mutisme et l'indiscible. L'équipe de recherche Psychogenèse et Psychopathologie, avec Véronique
Dufour et ses collaborateurs, montre que la banlieue est une mise en évidence de la post-modernité où se
rencontre chez les jeunes en difficulté une avant-garde des nouvelles formes d'expression des structures
mentales. La défaillance de la fonction paternelle s'y confronterait au réel d'une psychopathologie spécifique
qui s'exprime tant par le malaise du sujet que par le malaise dans la culture. Enfin, l'attention de Regnier Pirard
est retenue par la réflexion sur les processus de transmission de la psychanalyse en francophonie où rien ne
se transmet sans passer par des ruptures d'identification, condition de renouveau dans la théorie analytique..
Jean-François Chiantaretto montre comment l'écriture freudienne est une écriture de la persuasion qui installe
le lecteur au c¦ur du penser freudien, dans l'écriture des cas et celle des témoignages chez Freud. Nous avons
donné la parole à Émile Jalley, dans le cadre d'une Tribune libre où il présente et discute trois tableaux de
données qui rendent compte selon lui de l¹état institutionnel et intellectuel de la recherche en psychologie
universitaire.
Ce numéro est complété par :
Varia : Enfances dans la guerre
Le double traumatisme chez l'adolescent-combattant, Mouzayan Osseiran-Houballah
Les traumatismes, l'individuel, le collectif, Bernard Doray
revue par Simonne Daumas, Olivier Douville, Laure Étienne, Marie-Madeleine Jacquet, Guy Jehl, Pascal le
Maléfan, Martine Menes, Max Pagès, Loïck M. Villerbu, Claude Wacjman